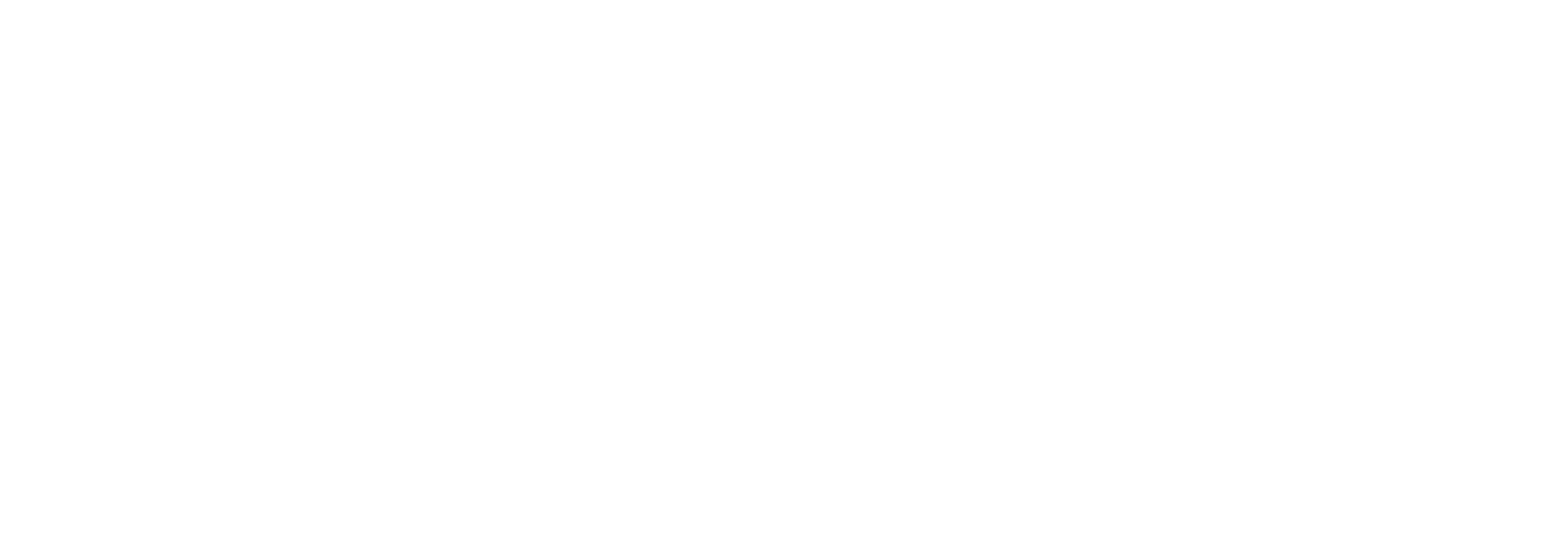Séminaire dédié aux pratiques de recherche responsable
L'École nationale des ponts et chaussées initie un cycle de séminaires dédiés aux pratiques de recherche responsable, en référence à un ensemble de principes, de pratiques et de responsabilités qui visent à garantir des processus de recherche rigoureux, éthiques et fiables, tout en prenant en compte les impacts plus larges de la recherche sur la société et l’environnement.
► Cette première session aura lieu en amphi Navier à l’ENPC le jeudi 12 juin de 14h à 17h.
Il est soutenu par le projet ERC Synergy NanoBubbles. Entrée libre.
La science s'autocorrige-t-elle ? Une histoire d'obscurantisme, de lenteur, et de manque d'intégrité scientifique. Lonni Besançon, Université de Linköping (Suède)
Bien que la réponse scientifique à la COVID-19 ait été remarquable, elle a réussi malgré d'importantes failles du système de diffusion scientifique, caractérisé par l'obscurantisme, la politisation et des mécanismes de correction insuffisants. Cette présentation interactive examine des formes fréquentes de mauvaise conduite, telles que la manipulation de données, la fraude à l’évaluation par les pairs et les paper mills, et souligne les solutions offertes par la Science Ouverte comme outils essentiels pour restaurer l'intégrité de la recherche. Les participants seront activement impliqués dans la détection et la compréhension de ces problèmes.
Etre responsable et intègre au CEA : retour sur une enquête qualitative. Catherine Guaspare et Michel Dubois, CNRS, Laboratoire GEMASS
Dans cette intervention, nous présenterons une première analyse d’une série d’entretiens menés au CEA et qui interrogent des scientifiques sur l’intégrité et leur responsabilité sociale. En préalable à cette présentation, nous reviendrons sur les principaux enseignements établis par des enquêtes antérieures menées au Cnrs et à l’Inserm sur ces différentes dimensions.
Objectivité, neutralité et responsabilité des sciences : le cas des mathématiques, ou la fin d’une « exception éthique ». Marlène Jouan, Institut de philosophie de Grenoble, Université Grenoble-Alpes, IUF
En matière d’éthique de la recherche, les mathématiques font traditionnellement figure d’exception : au mieux, elles seraient concernées par les exigences de l’intégrité scientifique, mais seraient légitimement exemptées de toute réflexion relevant de la responsabilité sociale et environnementale des sciences. Une déconstruction de ce statut d’exception est pourtant en cours, qui interpelle en premier lieu les mathématiques appliquées mais sans épargner non plus les mathématiques pures, et qui interroge la pertinence même de cette distinction. À l’appui de plusieurs exemples – de l’intelligence artificielle aux sciences du climat en passant par la cryptographie et les mathématiques financières – on montrera que la discipline n’est plus aujourd’hui immunisée contre la critique de la neutralité des sciences, et donc contre une problématisation morale et politique des connaissances qu’elles produisent.